Livre
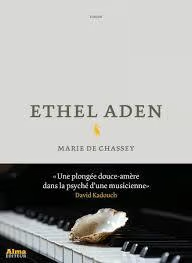
Marie de Chassey
ETHEL ADEN
Les répétitions,
les concerts... le trac
Selon un premier regard, le portrait que dresse Marie de Chassey de son personnage de musicienne dans son dernier roman n’est pas toujours avantageux. Pour tout dire, il possède même par moments quelque chose d’assez exaspérant. C’est seulement en progressant dans la lecture que l’on comprend que ce personnage renferme une fragilité extrême autant qu'une dureté implacable. C’est notamment la présence de cette ambivalence de caractère qui rend cet ouvrage si intéressant car elle évoque parfaitement les contradictions, les antagonismes, qui hantent parfois les artistes musicaux appelés à « performer » à haut niveau.
Ethel Aden est une pianiste concertiste de rang mondial. Pour elle — comme c’est le cas pour un grand nombre de musiciens et de musiciennes —, jouer est « le seul moment où elle existe vraiment ». Comme il se doit, le piano est omniprésent, au cœur de la vie de tous les jours. Un piano, tantôt ami et confident, tantôt tyran envahissant et intraitable.
Une espèce de misanthropie particulière anime Ethel. La plupart des personnes qu’elle est amenée à côtoyer l’insupportent. Elle ne tolère pas qu’on la contredise, beaucoup de choses l’exaspèrent : signer des autographes, répondre aux interviews, subir les bains de foule, participer aux tournées durant lesquelles aucune pause touristique n’est possible, entendre les babillages relatifs à la façon dont elle a joué durant ses concerts... Le tic tac des horloges l’horripile, la forme et la couleur de sa lampe de piano la contrarient, la mauvaise humeur la gagne lorsqu’elle a le ventre vide...
Ethel Aden se montre également plutôt odieuse, voire cruelle, avec son entourage. On a par exemple souvent envie de se ranger aux côtés de son malheureux assistant qui « la dérange » et qu’elle tient pour un moins que rien alors que ce dernier la véhicule, appelle les taxis, réserve les chambres d’hôtels, la guide dans son agenda, porte son linge au pressing, remplit son frigo, prend ses rendez-vous chez le coiffeur... Ce pauvre factotum ne bénéficie pas d’une once de considération : « Il fait partie de ces objets qui la rassurent.» [...] « Elle lui demanderait bien de se taire. Mais elle se contente de ne pas l’écouter. » Le traitement qu’elle accorde d’autre part à son petit ami avec lequel elle entretient une liaison laborieuse, maussade et grinçante n’est guère plus aimable.
Au surplus, le récit de Marie de Chassey exprime une plainte intime profonde et douloureuse. Ethel Aden est en outre la proie d’une sorte d’équilibre instable généralisé, d’une immense désorientation. Elle « se perçoit (...) morcelée.» Elle a le sentiment d’être ballottée au gré d’autrui. En regard de cela, elle est éperdument éprise de liberté. Même si elle revêt parfois des formes excessives, autoritaires, dérangeantes, sa volonté d’autonomie est féroce. Elle ne veut pas se laisser manœuvrer ; elle ne veut pas que l’on « mène la danse » à sa place. Comme soliste, elle s’enorgueillit de se soustraire aux injonctions impératives des chefs d’orchestres. Comme amante, elle ne se laisse pas imposer l’initiative. La plume concise et directe de Marie de Chassey nous fait bien saisir ce que ressent son personnage.
Ce qui domine dans le quotidien de cette concertiste, c’est la peur. En situation de concert, la peur « des autres » et celle « de ne pas y arriver ». Dans sa vie personnelle, la peur qui fait que l’estime de soi se dégrade, que le rapport à autrui se complexifie et se rigidifie, que l’individualité perd de son naturel. Égarée, partagée, taciturne, Ethel erre dans un monde qui l’étouffe.
Bien sûr, il y a aussi cette autre appellation bien connue de cette peur : le trac ! Un trac qu’il faut chaque fois surmonter, un trac qui vient parasiter l’exécution mais la plupart du temps heureusement in fine sans la compromettre.
Le trac, encore le trac, toujours le trac... C’est bien là une des thématiques centrales qui traverse cette fiction romanesque au réalisme sombre et dramatique. Éprouver le bonheur de jouer en public sans alarme, anxiété ni entraves... Ne plus avoir le sentiment lors des concerts d’avancer constamment sur le fil du rasoir ou de parcourir un chemin semé d’épines... La quête d’une sérénité physique et mentale heureuse et pérenne lors de l’éxécution instrumentale ou vocale est une quête que poursuivent nombre de musiciens et musiciennes. Elle n’est pas inatteignable. En matière de décontraction absolue devant le piano, un des maîtres modèles reste sans doute Arthur Rubinstein (1887-1982). Lorsque l’on lit ses mémoires — Les jours de ma jeunesse — et que l’on écoute les personnes qui l’ont rencontré, on est frappé par la disponibilité et la désinhibition qui émanaient de cet immense pianiste, disponibilité et désinhibition qui n’étaient pas chez lui une posture mais bien une réalité complète, authentique.1
Au profit de son personnage de concertiste, Marie de Chassey ne ferme pas la porte dans son ouvrage à cet état apaisé au service de la musique où peuvent être exclus les effrois et les tourments, où peuvent se trouver restaurer la joie et la confiance.
Didier Robrieux
Marie de Chassey
ETHEL ADEN
Alma éditeur, août 2025
____________________
1. Les mémoires d’Arthur Rubinstein sont parsemés de phrases où la gêne de jouer au débotté ou dans n’importe quelle circonstance n’est jamais présente ! Tel cet exemple emblématique de dialogue :
— Voudriez-vous me jouer quelque chose ?
— Avec joie, répondis-je.
(Arthur Rubinstein, Les jours de ma jeunesse, Ed. Robert Laffont, p. 270)
Et Arthur Rubinstein de s’exécuter sans peur ni cérémonie de la façon la plus naturelle qui soit...
[ Novembre 2025 ]
DR/© D. Robrieux